Rapports de force à l'Assemblée : les questions posées par le séisme des législatives
Rapports de force à l'Assemblée : les questions posées par le séisme des législatives
Publié le mardi 21 juin 2022 à 17:12

(AFP / STEPHANE DE SAKUTIN)
© AGENCE FRANCE-PRESSE | 2024 | Tous droits réservés.
- Auteur(s)
AFP France
Les résultats des élections législatives, qui ont privé Emmanuel Macron à peine réélu de majorité absolue, ont soulevé de nombreuses questions : le président peut-il dissoudre cette Assemblée tout juste élue ? Qui est la principale force d'opposition ? Quel opposant obtiendra la présidence convoitée de la Commission des finances ? Elisabeth Borne est-elle tenue de prononcer une déclaration de politique générale ? Et de la soumettre au vote des députés ? Tour d'horizon.
Jean-Luc Mélenchon a-t-il appelé à voter pour Emmanuel Macron à la présidentielle ?
C'est une bataille que le deuxième tour des législatives n'a pas définitivement tranchée : qui, de La France insoumise (LFI) ou du Rassemblement national (RN), sera le premier parti d'opposition dans le futur hémicycle ?
Pour revendiquer ce rang, la formation de Marine Le Pen a trouvé un argument de choc : Jean-Luc Mélenchon et ses proches seraient discrédités d'office puisqu'ils ont assuré la réélection d'Emmanuel Macron en appelant à voter pour lui dans l'entre-deux tours de la présidentielle.
"Comment voulez-vous que madame (Clémentine, ndlr) Autain et ses amis qui ont fait élire Emmanuel Macron puissent être une opposition ?", a affirmé, dimanche soir, la porte-parole du RN Laure Lavalette sur le plateau de France 2, lors d'un échange tendu avec la députée insoumise de Seine-Saint-Denis. "Le peuple n’a pas été dupe et on a bien vu que vous étiez les deux faces de la même pièce", a-t-elle poursuivi, accusant LFI d'avoir "appelé à voter pour le candidat de la retraite à 65 ans".
Marine Le Pen avait déroulé le même argumentaire le 14 juin sur RTL. "Je dis à mes électeurs: +vous votez pour nous et vous aurez ce que nous vous avons promis: c’est à dire une opposition réelle, réelle pas une opposition à la Mélenchon qui appelle à voter et à faire élire Emmanuel Macron+", avait-elle assuré, quand son lieutenant Jordan Bardella accusait lui aussi le leader insoumis d'avoir "fait élire" le chef de l'Etat.
"Jean-Luc Mélenchon n'est pas un opposant, c'est l'opposant qu'a choisi Emmanuel Macron, ils ont passé un deal", @MLP_officiel dans #RTLMatin avec @VenturaAlbapic.twitter.com/uLAd7gvqe1— RTL France (@RTLFrance) June 14, 2022
C'est toutefois bien plus compliqué que cela.
Après le premier tour de la présidentielle, dont il est arrivé troisième, Jean-Luc Mélenchon n'a en réalité jamais explicitement appelé à voter pour Emmanuel Macron, même s'il a formé le voeu qu'aucune voix n'aille vers la candidate d'extrême droite.
Le candidat insoumis s'était ainsi distingué des autres représentants de la gauche à la présidentielle qui, de Anne Hidalgo (PS) à Fabien Roussel (PCF) en passant par Yannick Jadot (EELV), ont clairement appelé leurs électeurs à voter pour Emmanuel Macron pour faire "barrage" à l'extrême droite.
"Il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen", avait simplement affirmé Jean-Luc Mélenchon dans son discours à l'issue du premier tour du 10 avril, répétant cette phrase à quatre reprises pour éviter tout malentendu. "Des fois, il arrive que même quand je dis les choses c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors, je recommence", avait-il plaisanté.
En 2017, après le premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait refusé de donner la moindre consigne de vote pour départager déjà Emmanuel Macron et Marine Le Pen, refusant toutes "les leçons de morale",une position qui avait suscité une cascade de critiques chez les dirigeants d'En Marche! mais aussi chez certains cadres du PS, proches de François Hollande.
En 2022, comme cinq ans auparavant, le parti insoumis avait en revanche lancé une consultation auprès de ses sympathisants pour connaître leurs intentions pour le second tour du 24 avril. Selon les résultats publiés le 17 avril, 37,6% des 215.292 voix exprimées avaient plébiscité le vote blanc ou nul ; 33,4% penchaient pour un vote Macron et 29% pensaient s'abstenir. Le vote en faveur de Marine Le Pen ne figurait pas parmi les options proposées.
Selon ses initiateurs, cette consultation n'avait toutefois qu'une valeur purement indicative. "Le résultat de cette consultation n’est pas une consigne donnée à qui que ce soit. Il indique quelles sont les appréciations des 215.292 personnes qui y ont participé. Chacun conclura et votera en conscience, comme il l’entend", prévenait ainsi un texte en préambule.
Difficile de savoir précisément ce qui en a été dans les urnes. Selon un sondage Ispos-Sopra Steria réalisé lors du second tour de la présidentielle, 42% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont glissé un bulletin Macron dans l'urne contre 17% pour Marine Le Pen, 17% ayant voté blanc ou nul et 24% ayant choisi de s'abstenir. L'institut BVA donnait, lui, un report de voix vers Emmanuel Macron deux fois supérieur à celui en faveur de Marine Le Pen (36% contre 18%).
La présidence de la Commission des finances revient-elle au "principal groupe d’opposition " ?
Dès le lendemain matin des législatives, tant le RN que la Nupes ont revendiqué la stratégique présidence de la Commission des finances de l'Assemblée, occupée, depuis 2007, par un membre de l'opposition parlementaire.
Entre le RN et la Nupes, les macronistes ont-ils une préférence ? "Mais pardon de vous dire, ce n'est pas une question de préférence ! Constitutionnellement, (le RN) c'est le premier groupe d'opposition", a répondu, sur France Info, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, arguant que la Nupes était une coalition de partis ayant prévu de siéger dans des groupes séparés.
Le RN à la tête de cette Commission, "bien sûr que ça me choquerait, mais de même que si la Nupes ou si LFI était majoritaire, la Constitution s'impose à nous. Il ne faut jamais jouer avec les éléments constitutionnels", a développé M. Fesneau, auparavant ministre des Relations avec le Parlement.
Mais c'est inexact à double titre. Premièrement, à aucun endroit la Constitution ne fait référence à la Commission des Finances, ni à sa présidence.
"Ce n'est pas de portée constitutionnelle. C'est inscrit dans le règlement de l'Assemblée", précise à l'AFP Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille.
Deuxième imprécision: l'article 39, alinéa 3, du règlement de l'Assemblée nationale ne précise pas que ce poste doive revenir au "principal"groupe d'opposition. Simplement qu'il échoit à "un député membre d'un groupe s'étant déclaré d'opposition".
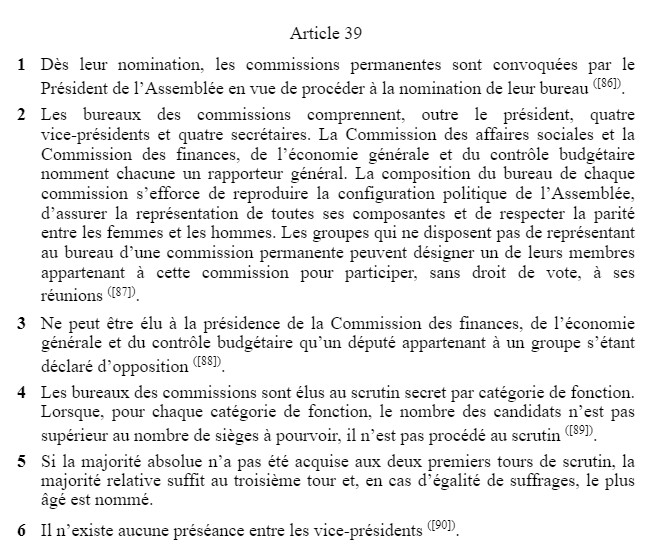
"Depuis 2007, c'est vrai que c'est la tradition, mais ce n'est pas une obligation", explique Mathilde Philipe-Gay, professeur de droit constitutionnel à l'Université Lyon III.
Cette innovation remonte à 2007. A la suite d'une promesse de campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, le député socialiste Didier Migaud fut élu à ce poste dans une Assemblée dominée par la droite.
Elle a ensuite été formalisée en 2009 par une résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale.
Après le scrutin de dimanche, le RN "revendique" cette présidence, arguant être le plus important groupe d'opposition. "Ce serait la moindre des choses et ce serait l'application, tout simplement, de nos textes", a jugé, sur France Info, le néo-député RN Philipe Ballard. Ce qui est donc inexact.
Et la gauche en fait de même. "La principale force d'opposition politique, c'est la Nupes qui a dans son protocole d'accord un intergroupe et qui présentera un seul ou une seule candidate", a ainsi de son côté expliqué sur France 2 le député LFI Eric Coquerel, qui s'est dit intéressé par le poste.
Mais comme le précise le règlement de l'Assemblée, ce président doit être "élu" par les autres membres de la commission. Quel qu'il soit, il devra donc franchir l'étape du vote auquel pourront participer les membres des autres groupes.
"Etant donné la nature technique de ce poste, il faut pouvoir compter sur une personne compétente, à l'aise avec les finances publiques, donc ce critère joue aussi dans l'élection", relève Guillaume Tusseau, professeur à l'école de droit de Sciences-Po.
La Première ministre est-elle obligée de soumettre son gouvernement à un "vote de confiance" ?
En l’absence de majorité absolue des macronistes à l’Assemblée nationale, "je ne sais pas comment(le gouvernement) réussit à avoir le vote de confiance", a déclaré la députée LFI Clémentine Autain, au micro de France Info, le 20 juin, évoquant un "problème institutionnel qui nous est posé".
A en croire l’élue, pour "démarrer tout projet de loi soumis à l’Assemblée nationale", la Première ministre, Elisabeth Borne, "doit faire un discours de politique générale" devant les députés, ce qui impliquerait de mettre la responsabilité de son gouvernement en jeu à travers un vote de confiance. Une affirmation immédiatement contredite par le journaliste Marc Fauvelle, ce dernier soulignant que le gouvernement "n’est pas obligé de mettre sa responsabilité en jeu".
"Je ne sais pas comment le gouvernement va obtenir le vote de confiance”, estime Clémentine Autain, députée Nupes - LFI. “Mme Borne est en difficulté pour rester. Emmanuel Macron va bricoler des majorités en cherchant plus à droite.” pic.twitter.com/OzG4Uo89w4— franceinfo (@franceinfo) June 20, 2022
Qui a raison ? Pour Emilien Quinart, maître de conférences en droit public à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne joint par l’AFP, "le vote de confiance n'est pas obligatoire."
La déclaration de politique générale, elle non plus, n’est "pas une obligation", indique par ailleurs à l’AFP Guillaume Tusseau, professeur à l’école de droit de Sciences Po, même si elle reste "intuitivement attendue du Premier ministre".
Dans le détail, l’article 49-1 de la Constitution de 1958 dispose que "le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale". Une décision cruciale, car si l’Assemblée vote contre, le Premier ministre et le gouvernement doivent démissionner.
"Le problème de l’article 49-1, c'est que dès l'origine, en 1958, on ne savait pas s'il s'agissait d'une obligation pour le Premier ministre ou d'une faculté", explique à l’AFP Elina Lemaire, constitutionnaliste et maître de conférences à l’université Bourgogne-Franche-Comté.
"Entre 1959 et 1966, le Premier ministre engageait systématiquement sa responsabilité. Mais il y a eu une rupture en 1966 avec Georges Pompidou", poursuit-elle, évoquant le cas où le Premier ministre du général de Gaulle n’avait pas engagé la responsabilité de son gouvernement. Une décision qui avait entraîné le dépôt d’une motion de censure par l’opposition - sans succès.
"De ce précédent, il est apparu que le gouvernement était libre de poser ou non la question de confiance au moment de sa formation", conclut Elina Lemaire.
Depuis lors, comme le rappelle Lauréline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnel à l’université Sorbonne-Nouvelle, "les Premier ministres n’ont pas toujours engagé leur responsabilité sur cette déclaration".
"C’est arrivé quatre fois qu’il n’y ait pas d’engagement : avec Michel Rocard en 1988, Edith Cresson en 1991, Pierre Bérégovoy en 1992, et bien avant avec Maurice Couve de Murville en 1968”, poursuit-elle.
Le 23 juillet 2008, une révision constitutionnelle a introduit une nouvelle disposition : l'article 50-1 qui confère au gouvernement l’option de faire une "déclaration qui donne lieu à débat" sur un sujet déterminé, et qui peut, s'il le décide, "faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité".
Cette déclaration s’effectue "devant l’une ou l’autre des assemblées". Elle peut également être demandée au gouvernement par un groupe parlementaire, mais le gouvernement peut refuser.
L’article 50-1 a été utilisé par le passé pour des sujets variés : programme de stabilité européen, orientations des finances publiques, ou encore récemment sur la guerre en Ukraine.
Clémentine Autain a également déclaré que la France insoumise pourrait choisir d'opter pour une motion de censure. Les Insoumis ont depuis prévenu qu’ils déposeraient une motion de censure contre le gouvernement le 5 juillet prochain.
Selon l’article 49-2 de la Constitution, cette procédure peut être enclenchée par l’opposition, à condition de réunir "au moins un dixième" de l’Assemblée, soit 58 députés. Le vote doit alors avoir lieu "quarante-huit heures après". En cas de majorité favorable, le gouvernement est renversé. Mais jusqu’ici, seul celui de Georges Pompidou a subi ce sort, en 1962.
Emmanuel Macron peut-il dissoudre l'Assemblée quand il le veut ?
Face à l’absence de majorité absolue pour Macron, la tentation d’une dissolution ? Le chef de l'Etat n'a pas pris la parole à ce stade mais l'hypothèse a été largement évoquée sur les plateaux télé dans la soirée de dimanche, ainsi que sur les réseaux sociaux : "Il est obligé d'attendre un an sauf bien sûr s'il s'assoit sur la Constitution", "Pas besoin d'attendre un an, il peut dissoudre quand il veut", "Non il faut attendre un an après la dernière élection législative"...toutes les opinions s'affrontent. Pour le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau (MoDem), cela "reste toujours une possibilité constitutionnelle".
C'est l'article 12 de la Constitution qui confère au président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Il dispose que "le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale" et "qu'il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections".
A quoi font référence les mots "ces élections"? Pour les dix spécialistes de droit constitutionnel interrogés par l'AFP la réponse ne fait aucun doute. "Il n'y a pas trop de marge de manoeuvre dans l’interprétation de l’article 12. 'Ces élections' ce sont celles qui ont fait suite à cette dissolution", analyse Aïda Manouguian, constitutionnaliste et docteur en droit public. Le chef de l'Etat doit donc attendre un an après une dissolution pour pouvoir dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale, l'esprit de l'article étant "de garantir que la dissolution ne puisse pas devenir un mode de gouvernement", explique Anne Levade, professeur de droit public et présidente de l'Association française de droit constitutionnel.
Sept autres experts interrogés séparément par l'AFP partagent la même analyse.
Et après des élections législatives ordinaires ? "Il n’y a absolument aucun obstacle ni condition de délai", poursuit Anne Levade. "Il peut tout à fait dissoudre demain s’il le souhaite, en tout cas juridiquement", abonde Jean-Pierre Camby, professeur associé à l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui souligne que "dans l’état actuel de la jurisprudence", un décret de dissolution n'aurait pas à être soumis au Conseil d’Etat ou au Conseil Constitutionnel.
Sur les quinze précédentes législatures de la Ve République, cinq ont été interrompues par une dissolution. Le général De Gaulle a dissous par deux fois l'Assemblée (lorsque les députés ont renversé le gouvernement de Georges Pompidou en 1962 et après Mai-68), tout comme François Mitterrand (en 1981 dans la foulée de son élection puis en 1988, après sa réélection). Jacques Chirac a choisi de dissoudre l'Assemblée en 1997 mais a été désavoué par les électeurs qui ont choisi une majorité de gauche, provoquant une cohabitation avec Lionel Jospin.
 Lionel Jospin et Jacques Chirac à l'Elysée en janvier 2001 à l'Elysée, à l'issue d'un Conseil des ministres (AFP / GEORGES GOBET)
Lionel Jospin et Jacques Chirac à l'Elysée en janvier 2001 à l'Elysée, à l'issue d'un Conseil des ministres (AFP / GEORGES GOBET)
Pour Emmanuel Macron le pari d'une dissolution rapide serait à risque.
"Constitutionnellement, il pourrait dissoudre dans les jours qui viennent, mais politiquement, ce serait très dangereux", estime Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'université Panthéon-Sorbonne. "Politiquement, Emmanuel Macron a tout intérêt à attendre afin d'avoir une justification objective de la dissolution", comme un blocage à l'Assemblée, poursuit-il.
"Ce serait même un suicide politique compte tenu de l'antimacronisme qu'il y a dans le pays", affirme le politologue Pascal Perrineau. "A mon sens, ce ne serait pas opportun politiquement tout de suite. Il y aurait un risque à mettre en jeu une majorité même relative", souligne Aïda Manouguian. La coalition présidentielle Ensemble! a obtenu 245 sièges à l'issue du second tour, la majorité absolue étant à 289.
A ce stade, les membres du gouvernement n'ont pas fait de déclaration en ce sens.
En tant que "force centrale dans cette nouvelle Assemblée", "nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action", a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne, cheffe de la majorité. "Quand vous avez un résultat comme celui(de dimanche), personne ne comprendrait qu'aujourd'hui ou demain matin, on décide de dissoudre l'Assemblée nationale", a jugé Marc Fesneau, ancien ministre chargé des Relations avec le Parlement.
Etait-il légal de diffuser les résultats des législatives en Outre-mer avant ceux de la métropole ?
De nombreux internautes ont fait part de leur surprise après la publication du résultat des législatives en Outre-mer dès dimanche matin, bien avant la clôture des bureaux de vote en métropole à 20H00.
En Guadeloupe, la préfecture avait par exemple rendu publique avant même 4H00 du matin (heure de Paris) la défaite de la Secrétaire d'Etat chargée de la Mer, Justine Benin. Ce communiqué, repris par l'ensemble des médias dont l’AFP avant l'ouverture des bureaux de vote en métropole, a été vertement dénoncée par plusieurs journalistes, qui y ont vu une nouvelle forme d’atteinte au code électoral (ici ou là).
Je ne sais pas ce qui arrive aux grands médias de craquer le scrutin des outre -mer mais attention à ne pas faire invalider tous les résultats pour influence sur le vote ! C’est pas possible d’enfreindre ainsi le code électoral ! Zut à la fin ! #JeVote— francoise degois (@francoisedegois) June 19, 2022
Or le code électoral n'interdit pas la diffusion des résultats pour les législatives. S'il est en effet proscrit de publier en métropole des résultats avant la fermeture des bureaux de vote dans l'Hexagone, les départements d'Outre-mer possèdent leurs propres règles pour les scrutins hors présidentielle.
L'article L52-2 du code dispose en effet que chaque département d'Outre-mer est autorisé à communiquer ses résultats après "la fermeture du dernier bureau de vote".
Or, depuis 2003, les électeurs ultra-marins de plusieurs départements votent en avance sur la métropole en raison du décalage horaire et afin d'éviter qu'ils soient déjà informés de l'issue du scrutin. "En raison du vote anticipé au sein de ces collectivités, les résultats du scrutin en Polynésie française, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon peuvent être annoncés avant la fermeture des bureaux de vote en métropole", confirme l'Arcom, le régulateur des médias contacté par l'AFP.
 Samedi 17 juin, dans un bureau de vote de Fort-de-France, en Martinique. (AFP / STEPHANE DE SAKUTIN)
Samedi 17 juin, dans un bureau de vote de Fort-de-France, en Martinique. (AFP / STEPHANE DE SAKUTIN)
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les résultats sont publiés en avance sur la métropole. En 2017, les résultats avaient déjà été diffusés aux aurores, et l'AFP avait annoncé la victoire à Saint-Pierre-et-Miquelon d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer du gouvernement d'Edouard Philippe à 2h49 du matin, heure de Paris.
La pratique est toutefois récente : en 2007 comme en 2012, les médias en métropole avaient dû attendre la fermeture des bureaux de vote dans l’Hexagone pour annoncer les résultats Outre-mer, qui avaient été pourtant déjà rendus publics localement.
En vue des élections de 2007, le CSA (ex-Arcom) avait en effet fixé cette règle, qui semble toutefois avoir été progressivement abandonnée avec l'évolution des moyens de communication et le recours croissant aux réseaux sociaux.

© AGENCE FRANCE-PRESSE | 2024 | Tous droits réservés. L’accès aux contenus de l'AFP publiés sur ce site et, le cas échéant, leur utilisation sont soumis aux conditions générales d'utilisation disponibles sur : https://www.afp.com/fr/cgu. Par conséquent, en accédant aux contenus de l’AFP publiés sur ce site, et en les utilisant, le cas échéant, vous acceptez d'être lié par les conditions générales d'utilisation susmentionnées. L’utilisation de contenus de l'AFP se fait sous votre seule et entière responsabilité.
